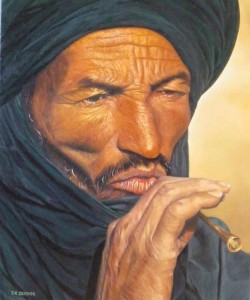Journée internationale des enfants-soldats : les romanciers africains témoignent
Sans verser dans un pessimisme profond qui peut être celui d’un stephen Smith dans Négrologie, il faudra reconnaître une banalisation de la violence politique dans l’Afrique postcoloniale. L’une des caractéristiques de cette violence atavique aux violences passées que le continent a connues, selon les mots de l’historien camerounais Achille Mbembé, est qu’elle trouve en son sein des adolescents et des enfants-soldats. Lesquels endossent concomitamment le statut ambivalent de victime et d’agent de guerre. De Ken Saro-Wiwa à Uzondinma Iweala en passant par Emmanuel Dongala, Ahmadou Kourouma ou encore Léonora Miano, Chris Abani, Chimamanda Adichie Ngozi, les auteurs africains dénoncent la guerre et l’implication des enfants. Le Bruit du Monde se place du point de vue de Kourouma et de Dongala pour raconter cette enfance en détresse.

Pourquoi Ces enfants s’engagent-ils ? : Kourouma vilipende les structures sociales et étatiques
Dans Allah n’est pas obligé, nous est dépeint les tribulations de Birahima, héros narrateur, dans les guerres libérienne et sierra-léonaise dans lesquelles l’ont entraîné Yacouba, le féticheur cupide et multiplicateur de billets. A la mort de sa mère, Birahima décide d’aller chercher sa tante au Liberia afin de lui assurer son « riz avec viande et sauce graine » (p36). De Charybde en Scylla, ils braveront de nombreux obstacles avant d’apprendre la mort de la tante une fois qu’ils ont retrouvé les traces de cette dernière. La montagne aura accouché d’une souris et tous les efforts de Birahima auront été vains. Le mât de cocagne que lui promet Yacouba( représentant l’adulte bourreau) se mue en cycle infernal de violence perpétrée par les adolescents qu’il rencontrera dans les nombreux camps où il sera tour à tour hébergé. Il comprendra de lui-même que la rétribution matérielle que lui a promise Yacouba est un leurre et qu’il devra plus se battre encore pour s’en sortir de l’ornière que s’il était resté au village même en tant qu’orphelin. Sa familiarité avec les camps qui le reçoivent et l’hébergent lui fait comprendre que la vie de l’enfant-soldat ressemble plus souvent au cauchemar qu’au rêve. Ce qui lui fait ironiquement dire ses propos pleins de sens : « L’enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin du vingtième siècle. Quand un soldat enfant meurt, on doit donc dire son oraison funèbre, c’est-à-dire comment il a pu dans ce grand foutu monde devenir un enfant-soldat. » (p94).
Dans la prononciation de ces oraisons funèbres en l’honneur de ses célèbres enfants-soldats, Kourouma, par le truchement de Birahima, nous fournit les raisons qui les conduisent à s’engager dans ces guerres. Sosso tue son père en réaction des violences que ce dernier infligeait à sa mère. Pour échapper à la justice sociale, il fuit le village et n’a d’autre choix que de s’engager : « Quand on n’a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d’oncle, quand on n’a pas de rien du tout (sic), le mieux est de devenir un enfant-soldat. Les enfants-soldats, c’est pour ceux qui n’ont rien à foutre sur la terre et sous le ciel d’Allah. » (p125). Kik l’a fait pour se venger de la morte de ses parents. Sékou, faute de pouvoir aller à l’école à cause de la situation financière difficile de sa mère, fait une fugue à Ouagadougou avant de retrouver le maquis libérien. Quant à Sarah, c’est pour ne pas « crever de faim » (p95) qu’elle décide de devenir enfant-soldat après que l’orphelinat dans lequel elle vivait a été détruit par les rebelles. Les enfants dont Birahima fait l’oraison funèbre sont tous des victimes directes ou indirectes de leurs sociétés respectives. Les groupements armés se substituent en asile pour ces enfants victimes des structures sociales, notamment la famille, et étatiques (l’école moderne). Ceci est révélateur d’un Birahima insolent et parlant si mal le français. Parce que n’ayant reçu aucune formation de base, ni moderne ni traditionnelle. Il ne s’agit pas pour Kourouma de faire revivre le substrat culturel malinké à travers l’oralité qui caractérise ses autres œuvres mais de dénoncer à travers le « français pourri » de Birahima une société aux abois et en perte de repères.
Dongala et la perspective manichéenne : un Afropessimisme ?
Si Birahima a été forcé par sa situation économique et par Yacouba à devenir enfant-soldat, Johnny Chien Méchant, du roman éponyme d’Emmanuel Dongala s’engage dans la milice par pure naïveté, enchanté par le discours « tribaliste » d’un « intellectuel ». Ce sont les « gros mots » de l’intellectuel qui le captivent. Pas le discours et la propagande des politiques qui montent les uns contre les autres. Puisque sortant lui-même avec Lovelita, appartenant appartenant à un autre groupe ethnique.
Il fallait plus que la sacro-sainte tribu pour me faire suivre aveuglément un homme politique. Et puis soudain tout avait basculé quand il avait dit qu’il était docteur en quelque chose, professeur dans une université quelque part. Là, j’avais vraiment prêté attention. C’est un intellectuel ! Dans notre pays, tout le monde en particulier les jeunes, admirait les politiciens, les militaires, les musiciens, et les footballeurs, bref, tout sauf les intellectuels, surtout pas les professeurs. Moi, je les respectais. Ils avaient des gros diplômes et parlaient un gros français, ils étaient plus intelligents que les politiciens, parce qu’ils avaient lu beaucoup de livres sur la politologie, la polémologie, la pharmacologie, la phrénologie, et la phénoménologie, la topologie, la géologie et là j’en passe car je n’ai cité que les disciplines dont j’ai entendu parler et je suis sûr qu’ils avaient lu des bouquins dans des disciplines dont je n’ai jamais entendu parler (Johnny : 105).
Moins naïf que Birahima, il comprenait trop bien les enjeux de la guerre civile dans son pays. En enfant-soldat délinquant, tuant, pillant et violant avec un malin plaisir, il rappelait ces mots pleins de sens.
Lorsque les combats avaient commencé, nous on savait seulement que, comme d’habitude, deux leaders politiques se battaient pour le pouvoir après des élections que l’un disait truquées et l’autre disait démocratiques et transparentes. Nous on s’en foutait puisque nous connaissions la nature des hommes politiques de chez nous. Tous des sorciers. Ils arrivaient à vous saouler avec des paroles plus sucrées que du vin de palme fraîchement récolté et pendant que vous vous laissiez bercer par le ronron de ces belles paroles, ils avaient vite fait de grimper sur votre dos pour atteindre le mât de cocagne qu’ils convoitaient et une fois là-haut, riches et bien gavés, ils vous pétaient dessus(100-101).
Donc Johnny la brute, guidé par Thanatos fait régner la terreur avec son kalachnikov qui atteint plus Laokolé, l’adolescente victime et co-narratrice du roman de Dongala. Ironiquement, la guerre de Johnny et de sa bande happe cette jeune fille le jour même où elle devrait passer son examen de baccalauréat. Dans sa folle fuite, avec sa mère cul-de jatte et son frère Fofo, elle devient aussitôt adulte en subissant de plein fouet les folies d’un Johnny sous l’emprise du haschich et des drogues dures.
A la fin du roman, les deux protagonistes, vont se rencontrer après la mort des êtres chers de Laokolé (Sa mère, sa tante et son frère) par la faute de Johnny et de ses affidés. Laokolé va surprendre Johnny en le frappant par une Bible (Justice divine ?) puis, en signe d’apothéose, lui écrabouiller ses organes génitaux qui ont humilié tant de femmes. Souffrances qui enverront le caïd Johnny ad patres, dépouillant par la même occasion Laokolé de son statut de victime. Aurait-elle été contaminé par le trop plein de violence qui l’entourait ?